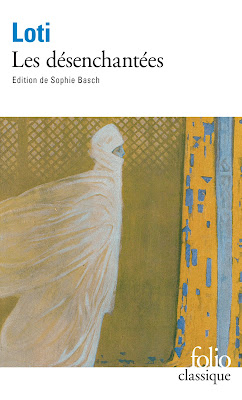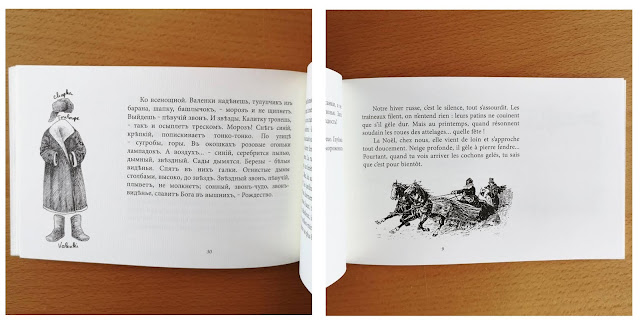Diantre ! Il y a longtemps que je n'avais pas été séduite à ce point par une plume (coucou Jules). C'est la première fois que je lis Pierre Loti, et je ne m'arrêterai certainement pas là (les recommandations sont comme toujours très bienvenues).
Pourtant, j'ai un peu hésité à écrire cet article en découvrant la genèse des Désenchantées. Je vais donc vous en parler brièvement.
La genèse des Désenchantées
Le sous-titre des Désenchantées est « roman des harems* turcs contemporains ». Je vous conseille de souligner plusieurs fois le mot « roman », puisqu'il est né d'une duperie : trois femmes se sont faites passer auprès de Loti pour des Turques et lui ont demandé d'écrire un livre sur « leur » condition. Problème : celle qui a inspiré le personnage principal féminin (Marie Léra) est en réalité française (pour vous dire son importance : ses lettres à Loti sont reproduites pratiquement telles quelles dans le roman).
Ses deux compagnes, quant à elles, sont certes turques mais fortement occidentalisées (d'ailleurs petites filles d'un Français) et auraient communiqué une version erronée de la condition des femmes turques à Pierre Loti (voir la préface de l'édition Folio).
► Par ICI pour plus de détails sur cette drôle d'histoire.
* « Le harem de nos jours, c'est tout simplement la partie féminine d'une famille constituée comme chez nous, — et éduquée comme chez nous, sauf la claustration, sauf les voiles épais pour la rue, et l'impossibilité d'échanger avec un homme, s'il n'est le père, le mari, le frère ou quelque fois par tolérance le cousin très proche avec qui l'on a joué étant enfant. »
Mais au final, ces inexactitudes ne sont pas importantes: 1) parce que c'est d'la balle et 2) parce que Les Désenchantées n'est pas un roman à thèse. À l'appui, cette citation de Loti et de Marie Léra (dans l'article du Figaro) :
« Pierre Loti accueillit d'un grand éclat de rire notre requête. "Moi, écrire un livre pour prouver quelque chose ? Je ne pourrais jamais !" La seule idée d'écrire un roman à thèse lui faisait horreur.»
Je crois qu'on peut difficilement être plus clair.
On trouve aussi quelques indices dans le roman :
« Il déchira l'enveloppe timbrée du cher là-bas, — et le contenu d'abord lui fit hausser les épaules : ah ! non, cette dame-là s'amusait de lui, par exemple ! Son langage était trop moderne, son français trop pur et trop facile. Elle avait beau citer le Coran, se faire appeler Zahidé-Hanum, et demander réponse poste restante avec des précautions de Peau-Rouge en maraude, ce devait être quelque voyageuse de passage à Constantinople*, ou la femme d'un attaché d'ambassade, qui sait ? ou, à la rigueur, une Levantine** éduquée à Paris ? »
*Bingo, l'asticot ; précisément, Armand ; élémentaire mon cher Albert (je pourrais continuer comme ça pendant 3 jours).
**Levantins : habitants de l'Asie Mineure qui ne sont ni turcs ni arabes (merci l'édition Folio, très bien annotée par Sophie Basch).
Le roman
Les Désenchantées est donc « roman » plus que témoignage sur « les harems turcs contemporains ».
Mais finalement, quel est le sujet de ce roman ? Je ne vais pas vous mentir : si vous cherchez de l'action, ce n'est pas ici que vous la trouverez (au cas où ce roman au pays des derviches ne vous tenterait pas, je vous rappelle que Potes en papier vous propose une sélection variée de page-tourneurs tels Le Chevalier de Maison-Rouge de Dumas, L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor, Gogol d'Henri Troyat (sisi : j'vous jure), Orgueil et préjugés de Jane Austen ou encore Seul sur Mars d'Andy Weir).
Les Désenchantées est surtout un exercice de style, et il aurait pu être écrit dans moult contextes différents, avec d'autres personnages. Mais le contexte et les personnages peuvent nous aider à cerner le sujet.
André Lhéry, romancier, voit la vieillesse approcher et se languit dans sa propriété du pays basque après une vie de voyages (rien à voir avec la vie de Loti *ironie*: on n'est pas sûrs que son personnage ait aussi une moustache), lorsqu'on lui offre l'opportunité de retourner à Istanbul, où il a connu une histoire d'amour dans sa jeunesse. Là-bas, il va entrer en relation avec la jeune femme évoquée dans l'extrait plus haut (la fausse fausse Turque, inspirée par Marie Léra, la vraie fausse Turque) et ses cousines (et je m'en vais prendre un Doliprane avant de pouvoir vous dire si ce sont des vraies fausses Turques, des fausses vraies Turques ou des fausses fausses Turques ; disons juste que, dans le roman, ce sont des vraies Turques).
Chez ces jeunes femmes, Lhéry retrouve quelque chose de son mal-être. S'il soupire après sa jeunesse, son amour perdu, et une époque révolue (il se désole de voir Istanbul se morderniser et perdre son âme) ; elles vivent tout près de l'agitation du monde mais ne peuvent l'aborder que derrière des grilles et des voiles, toujours surveillées.
« Et ils s'étonnaient, étant les uns pour les autres des éléments si nouveaux, ils s'étonnaient de ne pas se trouver très dissemblables ; mais non, au contraire, en parfaite communion d'idées et d'impressions. »
Ce n'est pourtant pas la tristesse qui prédomine. Finalement, toute l'histoire, la nostalgie de Lhéry et les contraintes des jeunes femmes sont des excuses pour décrire les moments de grâce que nos personnages arrivent à dérober.
« Comme il se sentait l'âme très turque, par ce beau soir de limpidité tiède, où bientôt la pleine lune allait rayonner toute bleue sur la Marmara, il revint à Stamboul quand la nuit fut tombée et monta au cœur même des quartiers musulmans, pour aller s'asseoir dehors, sur l'esplanade qui lui était redevenue familière, devant la mosquée de Sultan-Fatih. Il voulait songer là, dans la fraîcheur pure du soir et dans la délicieuse paix orientale, en fumant des narguilés, avec beaucoup de magnificence mourante autour de soi, beaucoup de délabrement, de silence religieux et de prière. »
Ce genre de passages compensent largement les quelques moments de mélodrame et cette impression que Loti flatte son ego en se peignant comme l'objet de l'amour d'une jeune femme un peu trop belle et intelligente pour être vraie (un petit lifting à coups de plume en somme). Disons que ça passera pour cette fois, parce qu'il a du talent.
Enfin je dois aussi avouer que lorsque j'ai découvert la véritable identité du personnage de Djénane (Marie Léra), le roman a perdu un de ses mérites : je croyais que Loti égalait Balzac dans son empathie pour les femmes (voir la première partie de La Femme de trente ans ; la seconde de La Muse du département ou encore Mémoires de deux jeunes mariées ; liste à mettre à jour quand j'aurai terminé La Comédie humaine). Ce personnage était attachant : désenchantée mais encore un peu enfant, passionnée et réservée, parfois férocement critique... Après coup, elle perd un peu de son charme.
À vous de voir si vous arrivez à passer par-dessus tout ça pour apprécier pleinement la plume de Loti. Je vous laisse un dernier extrait pour vous décider :
« Il les perdit de vue quand elles arrivèrent sous les grands platanes, dans le bois sacré qui est à l'autre bout de cette plaine fermée. Le soleil descendait derrière les collines, disparaissait lentement de cet éden ; le ciel prenait sa limpidité verte des beaux soirs d'été et les tout petits nuages, qui le traversaient en queue de chat, ressemblaient à des flammes orangées. Les autres ombres heureuses qui étaient restées longtemps assises, çà et là, sur l'herbe fleurie de colchiques, se levaient toutes pour s'en aller aussi, mais bien doucement comme il sied à des ombres. Les flûtes des bergers dans le lointain commençaient leur musiquette du temps passé pour faire rentrer les chèvres. Et tout ce lieu se préparait à devenir infiniment solitaire, au pied de ces grands bois, sous une nuit d'étoiles. »
*Second avertissement : La lecture de ce roman peut avoir pour effet secondaire le fredonnement continu d'un tube de Mylène Farmer (ce n'est pas un risque à prendre à la légère).