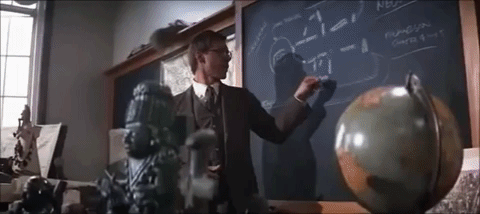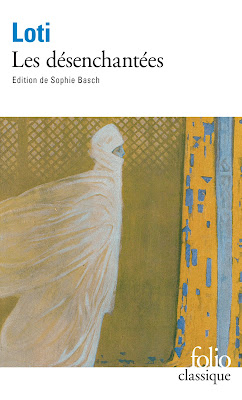Dans Dostoïevski, un écrivain dans son temps, Joseph Frank ne se contente pas de nous raconter la vie de Dostoïevski, aussi intéressante soit-elle ; il nous offre surtout de nombreuses clés de lecture de son œuvre, notamment en nous présentant les grands débats de son époque (1821-1881), qui préparent la révolution.
VIE DE DOSTOÏEVSKI
« En entrant dans l'immeuble où habitait Dostoïevski, elle eut une étrange impression : "C'était une grande maison composée d'une infinité de petits logements habités par des commerçants ou des artisans, et qui me fit penser à celle de Raskolnikov*."
[…] Le cabinet de travail, sombre et silencieux, "produisait une impression pénible". »
*le personnage principal de Crime et châtiment
Autant directement mettre les pieds dans le plat avec un cliché : mine de rien, la vie de Dostoïevski a quelque chose de ses romans ; du drame en veux-tu, en voilà ! Du drame familial, bien évidemment, mais pas seulement... Entre son épilepsie, sa carrière chaotique, son séjour au bagne, son addiction au jeu, et j'en passe, le récit de sa vie a de quoi captiver.
(Oeuvre et vie sont si bien liées qu'on retrouve, par exemple, le récit d'une de ses expériences les plus traumatisantes dans L'Idiot, et des références à au moins deux tragédies personnelles dans Les Frères Karamazov.)
Ce qui fait la force de cette biographie, c'est que Joseph Frank choisit avant tout de raconter les épisodes de la vie de Dostoïevski qui influencent son œuvre d'une manière ou d'une autre, sans forcer les analogies entre les deux (garantie 0% psychologie de comptoir).
Il faut également saluer l'honnêteté intellectuelle de Joseph Frank, qui n'hésite pas à montrer les côtés moins reluisants de l'auteur auquel il a consacré sa carrière universitaire.
Dostoïevski était colérique (trait qu'il impute lui-même à son épilepsie) :
« Il me plaît beaucoup, mais il me fait peur à cause de son caractère irascible et de sa maladie. »
(Anna avant d'accepter d'épouser Dostoïevski.)
Il était antisémite (bien que, paradoxalement, tout à fait capable de se comporter normalement avec les Juifs : cf. sa correspondance avec une jeune femme qui lui demandait des conseils sur son avenir) :
« Les juifs "avancent, ils emplissent l'Europe entière ; tout l'égoïsme, tout ce qui est ennemi du genre humain, toutes les mauvaises passions des hommes, ils les incarnent, comment ne triompheraient-ils pas dans leur projet d'anéantir le monde ?" » (lettre du 15 juin 1880)
Il était impérialiste :
« Pour Dostoïevski, l'expansion de la puissance russe en Asie centrale devait diminuer le prestige de l'Angleterre et contribuer à ce que, "jusqu'à l'Inde et jusque peut-être en Inde même, grandisse la conviction de l’invincibilité du tsar blanc et de la toute-puissance de son glaive".
[…]
"En Europe, nous avons été des ramasse-miettes et des esclaves, en Asie nous serons des seigneurs." »
(Journal d'un écrivain, janvier 1881)
Et sa vision de l'histoire était on ne peut plus exaltée :
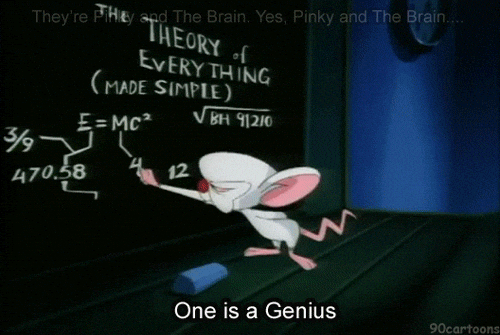 |
| Dans le cerveau de Dostoïevski |
« "Ils [les radicaux] ne se doutent même pas que la fin n'est pas loin... la fin de leur ‘progrès’, de tout leur bavardage ! Ils sont à mille lieux de soupçonner que l'antéchrist est né et qu'il arrive !" […] Comme elle* ne put s'empêcher de lui dire qu'il exagérait, il donna un coup violent sur la table et "cria, tel le muezzin sur son minaret : ‘Il vient, l'antéchrist ! Il arrive ! La fin du monde est proche, plus proche qu'on ne le pense !’" »
*Varvara Timofeïevna-Potchinkovskaïa, correctrice de la revue dont il était alors rédacteur en chef
(POV : on te ressort tous tes tweets)
Joseph Frank m'a confortée dans l'idée que l'on peut admirer le talent d'un écrivain, reconnaître qu'il nous a beaucoup apporté, sans pour autant chercher à l'idéaliser.
Maintenant que j'ai reconnu les défauts de Dostoïevski, je peux essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, dans sa personne comme dans son œuvre.
Un des passages les plus marquants que j'aie lus, tous auteurs compris, est celui des Frères Karamazov où Zossime, le starets (un directeur de conscience) affirme :
« il n'y a qu'un moyen de salut : prends à ta charge tous les péchés des hommes. En effet, mon ami, dès que tu répondras sincèrement pour tous et pour tout, tu verras aussitôt qu'il en est vraiment ainsi, que tu es coupable pour tout et pour tous. »
Comme Zossime, Dostoïevski aurait pu dire : « il est nécessaire d'aimer l'homme même dans le péché, car c'est là l'image de l'amour divin, il n'y en a pas de plus grand sur terre ». Je ne doute pas que c'est sa conviction personnelle.
On ne rencontre pas tous les jours quelqu'un qui se fait une idée aussi exigeante de l'amour des autres.
Je retiens aussi sa capacité exacerbée à la compassion (innée, mais aussi nourrie par ses terribles drames personnels), qui irrigue toute son œuvre : dans les vies misérables des familles Marmeladov (Crime et châtiment) et Sneguirov (Les Frères Karamazov) ; dans les tourments de Natassia Filippovna, la femme déchue de L'Idiot ou même dans ceux de personnages qui lui sont diamétralement opposés, comme Hippolyte Terentiev, l'athée mourant (toujours dans L'Idiot).
Joseph Frank à propos de Douce et Le Songe d'un homme ridicule : « On trouve dans ces nouvelles les aspects les plus touchants de la vision du monde de Dostoïesvki, sa profonde identification aux différentes formes de souffrance humaine, tant matérielles que spirituelles, et son invariable attachement à un idéal de la félicité humaine atteint par le respect du commandement chrétien de l'amour mutuel. »
J'ai également été touchée par sa relation avec sa femme, qu'il a aimée passionnément jusqu'à la fin de sa vie. (Dotée d'une résilience incroyable et d'une grande force de caractère, Anna Dostoïevskaïa est d'ailleurs la figure la plus marquante de cette biographie, avec son sujet principal).
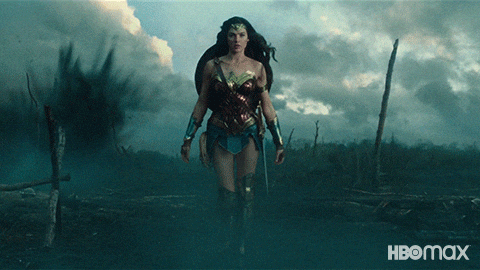 |
| Madame Dostoïevski après avoir négocié les dettes de son mari, fait toutes les recherches pour qu'il se lance dans l'auto-édition et dirigé les impressions. |
SON OEUVRE
En espérant avoir réussi à sortir de la zone de malaise (et sans condamner ceux qui seraient déjà partis en courant), je vais me tourner vers ce qu'il y a sans aucun doute à garder : son talent d'écrivain, que Joseph Frank sait si bien analyser et célébrer, comme en témoignent ces extraits :
- « [Dans l'œuvre de Dostoïevski,] l'essentiel n'est pas dans les disputes qui opposent les personnages. Il est dans le fait que leurs idées constituent une part de leurs personnalités, à tel point qu'idées et personnages deviennent indissociables.[...] Il avait ce que j'appelle une "imagination eschatologique", c'est-à-dire une imagination qui lui permettait de transformer les idées en actes, et de les suivre jusqu'à leurs ultimes conséquences. »
« Dans une des dernières notes de ses Carnets, il écrivait :
"Tout en restant pleinement réaliste, trouver l'homme dans l'homme. […] On m'appelle psychologue : c'est faux, je suis un réaliste au sens le plus élevé, c'est-à-dire que je peins toutes les profondeurs de l'âme humaine."
C'est ce "réaliste" qui occupe aujourd'hui une place importante dans le patrimoine culturel de l'humanité, non le patriote égaré brandissant le drapeau de la domination impériale. Mais la possibilité de la coexistence en un même individu de deux personnages aussi différents est une grande partie du mystère avec lequel le "psychologue" ne cessa de se débattre. »
Joseph Frank ne se contente pas de considérations générales sur l'œuvre de Dostoïevski ; il consacre en outre des chapitres à l'analyse de chacun de ses romans les plus importants (L'Idiot, Les Démons, Les Frères Karmazov,...) en reprenant tout le fil de leurs intrigues. Sa lecture de Crime et châtiment m'a aidée à mieux l'apprécier et m'a donné envie de le relire (alors que c'est un roman avec lequel j'ai eu du mal, les deux fois où je l'ai lu).
« Dostoïevski transfère à l'intérieur du personnage, dans sa psychologie, l'enquête traditionnelle des romans policiers, qui vise à découvrir l'identité du coupable ; dans Crime et châtiment, Raskolnikov mène l'enquête pour comprendre l'acte qu'il a lui-même commis. »
« D'un côté, il y a l'agapè des chrétiens, le sacrifice total, immédiat et inconditionnel du moi qui est la loi à laquelle obéit Sonia (et la valeur la plus élevée aux yeux de Dostoïesvki) ; de l'autre, il y a l'éthique rationnelle utilitariste de Raskolnikov, qui justifie le sacrifice des autres au nom d'un bien social supérieur. »
Enfin, Joseph Frank m'a impressionnée par sa connaissance de la vie intellectuelle de l'époque (passionnante, parce qu'elle se situe à un moment charnière de l'histoire russe), autant que par sa pédagogie.
Sa description du contexte éclaire considérablement l'œuvre de Dostoïevski.
« Crime et châtiment fut une réponse aux idées d'un penseur radical russe, Dmitri Pissarev. Au sein de la multitude endormie, celui-ci distinguait quelques individus exceptionnels qui, comme Raskolnikov, se croyaient autorisés à commettre des crimes pour le bien de l'humanité. […] Les Démons, qui reste le meilleur roman consacré à une conspiration révolutionnaire, s'inspire de ce qu'on appelle "l'affaire Netchaïev", l'élimination par ses camarades d'un jeune étudiant appartenant à un groupe clandestin. […]
Dostoïevski ne se contenta pas de combattre des idées. Il voulut aussi créer une image qui servirait d'exemple à la nouvelle génération. Dans L'Idiot, il propose un idéal de ce genre, opposé à l'"égoïsme rationnel" […] »
EN BREF
Dostoïevski, un écrivain dans son temps est un modèle de biographie littéraire qui m'a ramenée à mes meilleurs cours de fac, tout en me permettant de les approfondir. Mais je ne pense pas qu'il faille être un spécialiste pour comprendre. Il suffit de ne pas se déstabiliser si vous ne connaissez pas les noms de certains critiques russes, par exemple (comme ça a été mon cas quelquefois). L'auteur explique leurs idées et retrace leurs débats avec Dostoïevski, et c'est l'essentiel.
Par contre, si vous n'aimez pas les spoilers il faudra au moins éviter les chapitres consacrés aux œuvres que vous n'avez pas encore lues (ce que je n'ai pas fait, parce que ce bouquin est trop bien et que je ne voulais pas en laisser une miette).
Vous pouvez éventuellement commencer par lire les œuvres de Dostoïesvki qui vous tentent le plus ; au moins, celles-ci ne vous seront pas divulgâchées.
Et si vous ne savez par où commencer dans l'œuvre de Dosto, je recommande :
-Récits de la maison des morts (aussi traduits sous le titre Souvenirs de la maison des morts) : il s'agit de ses souvenirs du bagne, mais présentés comme ceux d'un narrateur fictif. Je trouve que c'est une excellente porte d'entrée dans l'œuvre de Dostoïevski parce que, s'il a été écrit avant ses grands romans, il aborde déjà les thématiques qu'ils approfondiront. C'est vraiment une de mes œuvres préférées de Dostoïevski, notamment pour la simplicité du ton, qui ne l'empêche pas d'être émouvante, et même drôle, parfois.
-Les Frères Karamazov : ma deuxième œuvre favorite ex-aequo avec les Récits de la maison des morts. Plus long mais absolument magnifique, c'est le dernier roman de Dostoïevski. Il y mêle dans une narration génialement maîtrisée plusieurs genres : drame familial, roman policier, dialogue philosophique, nouvelle fantastique, hagiographie, plaidoierie... Qui nous embarquent dans les quêtes de vérité d'Ivan, le rationaliste qui a du mal à faire le deuil du surnaturel ; de Dmitri, le jeune homme emporté et violent qui, plus que tout, désire aimer ; et d'Aliocha, le novice en proie au doute.